Paul Bedel et les autres dans Paris Match.
2 participants
Normanring :: Divers
Page 1 sur 1
 Paul Bedel et les autres dans Paris Match.
Paul Bedel et les autres dans Paris Match.
Boujou.
Frêle silhouette courbée par le temps et les vents, Paul Bedel, 79 ans, avance à petits pas dans son champ enneigé. Face à lui, la lande s’étire en pente douce jusqu’à la mer. Un bout du monde, ce cap de la Hague, aux confins de la presqu’île du Cotentin. Le vieil homme s’approche d’un muret entourant sa parcelle, afin de le consolider. Il se baisse péniblement, prend dans ses mains calleuses une pierre de granit qu’il appose aux autres, d’un geste habile. «Grâce à ces murs, explique-t-il, le foin sera mieux protégé des embruns salés.» Paul connaît les moindres recoins de ce rude paysage qui l’a vu naître. Il n’en est parti que pour son service militaire et pour se rendre à Lourdes. Quand l’usine de traitement des déchets toxiques de la Hague s’est construite, en 1961, les jeunes du coin ont voulu y travailler. «Moi, j’avais besoin d’avoir les mains noires de terre et l’immensité de la Manche devant les yeux. Ici, la lande, la mer et l’homme ne font qu’un. Je sais que, lorsque pousse le varech au printemps, quinze jours après l’herbe verdira. Dommage que les jeunes n’observent plus leur environnement. Leurs tracteurs sophistiqués les ont coupés de la nature qu’ils croient dominer.
Le bon sens terrien :
C’est faux ! Avec mes deux sœurs, célibataires comme moi, nous avons perpétué la tradition avec nos vieilles machines, notre petit élevage de vaches, nos quatre cochons et la basse-cour. Nous avons toujours pu vivre en autarcie, et même faire des économies», confie-t-il, malicieux. Cette existence simple, ce bon sens terrien des paysans français, Roger Lacharpagne, 54 ans, a su aussi les préserver dans le sud du Berry. Avec son père, Gaston, 85 ans, il possède des lopins de terre entourés de buissons piquants qu’ils remontent encore à la sarclette «pour retenir la terre et éviter que nos 25 moutons et 25 vaches ne changent de pré». Lui aussi est un fervent partisan d’une modernisation lente, où «épargner, c’est mieux qu’emprunter». «J’ai le dosage de nourriture au bout de la fourche. Pour un mouton, un seau d’avoine suffit. Un savoir-faire inné.» Fils unique, il n’a jamais pris un jour de vacances, comme ses parents. «On ne peut pas quitter les bêtes, alors je vois la mer à la télé !» Roger ne vit que pour ses animaux. Se couche à 21 heures mais peut se relever à minuit pour aider une vache à vêler. «La bonne surprise, c’est de voir en arrivant que le nouveau-né tète déjà sa mère. Aucune mécanique ne pourra jamais remplacer la magie de la nature.» Son seul désir aujourd’hui : «Libérer les bêtes de la chaîne.» Dans la cour de la ferme, non loin du tas de fumier, s’ouvre l’étable.
Une dizaine de vaches rousses sont allongées, le cou entravé. Odeur de bouse et d’urine. Gaston empoigne la fourche en bois et nettoie la paille souillée. Impression d’avoir basculé au siècle dernier... Au bout de six générations, le clan Geoffroy, lui, a su allier la tradition à la modernité, par une transmission du savoir de père en fils. Un héritage dont Roger et Paul ont la nostalgie. Ils redoutent d’ailleurs de devoir vendre la ferme de leurs aïeux. Mais, à leur époque, rares étaient les jeunes femmes prêtes à travailler nuit et jour... Rien de tel pour les Geoffroy, qui sont devenus céréaliers en Poitou-Charentes. «J’ai toujours été en avance sur mon temps, raconte Charles, le grand-père. En un seul jour, j’ai acheté trois tracteurs... C’est bien beau, le folklore, mais qu’est-ce que j’en ai bavé pour entasser le foin ! On avait tous mal au dos. Et quand il fallait couper le blé à la faucille ! L’horreur ! Ils sont plus heureux, les paysans d’aujourd’hui. Cultiver des céréales dans des tracteurs climatisés dirigés par satellite, quel plaisir !» Alors qu’il s’occupait d’une vingtaine de vaches laitières, il n’a pas hésité à sauter le pas avec l’aide de son fils et de la Pac (politique agricole commune). Maintenant, face à ses champs mordorés qui s’étendent à perte de vue, il s’amuse, à 80 ans, à jouer au «gentleman farmer», tout en surveillant du coin de l’œil le travail de ses deux petits-fils, juchés sur leurs monstres mécaniques, des moissonneuses-batteuses dont les roues mesurent 2 mètres de diamètre... Les cheveux en bataille, la mine burinée, Sylvain Meyrat, lui, se présente, non sans fierté, comme «un berger sans terre, un nomade qui n’a pas eu la chance d’hériter de pâturages ou de bestiaux». Mais, dans ce coin perdu des Hautes-Pyrénées, le temps des estives, de juin à septembre, ce Basque de 39 ans, dont le regard brille d’un éclat sauvage, se dit «heureux» quand il veille sur un troupeau de 180 brebis manech. Après les avoir emmenées brouter dans les prairies d’altitude, il les guide avec virtuosité sur des sentiers escarpés, vers leur enclos, en contrebas. Deux fois par jour, il les trait à la main pour obtenir 50 litres de lait. «Je fabrique du fromage, je vends des agneaux et je squatte la caravane d’un vieux du coin. Voilà ma vie l’été. Pour l’hiver, on verra bien.»
Le refuge des assoifés d'espaces vierges :
Les vallées encaissées des Pyrénées attirent ces assoiffés d’espaces vierges. Des jeunes gens qui ont fui l’isolement des grandes villes, attirés par une vie saine, rythmée par les saisons. A la ferme équestre de Bernicaze, Adeline Abdallah, 28 ans, a repris un élevage de 50 chevaux de promenade légués par son père. Plantureuse et volontaire, la jeune femme partage un potager avec ses amis afin de consommer des fruits et légumes bio qu’ils cuisinent ensemble selon d’anciennes recettes. Ce jeudi ensoleillé de juin, Eric, un jeune botaniste, leur a concocté une soupe à base de laurier qu’il a ramassé le long des chemins.
Autour de la grande table de la ferme, où chacun passe sans prévenir, on retrouve l’esprit communautaire des hippies des années 70 avec des «rebelles» sans les cheveux longs et mieux intégrés socialement, tel Marc, 30 ans, prof de français, qui enseigne à Lourdes après avoir quitté la banlieue parisienne, «bien trop étouffante»... A Sigottier, village perché dans les Hautes-Alpes, les Lanteaume, Bernard, Catherine et Lilas, 7 ans, n’échangeraient pour rien au monde les chèvres angoras et cachemires dont le couple transforme la laine artisanalement. «En 1983, j’en ai ramené une quarantaine du Texas, par camion, à travers les Etats-Unis jusqu’au Canada, pour éviter les problèmes de douane. Puis elles ont pris l’avion, à nouveau un camion et, au bout d’une semaine, elles sont enfin arrivées à la maison, saines et sauves ! Depuis, elles se sont multipliées, gambadent sur les à-pics des montagnes alentour et, entre mai et novembre, restent sur les sommets, gardées par les patous, des chiens de berger efficaces.» Avec leur vente directe de lainages de qualité et leur gîte rural qui domine la vallée, ils ont réussi leur pari.
Dans un coin du nord de la Bretagne, enivrés d’iode, Monique Poulet et Michel Pertzinsky profitent de la marée basse pour ramasser avec ardeur des brassées d’algues, ravis de trouver «tant de laitue de mer, aujourd’hui». «En 1993, Michel et moi vivions en Normandie. Nous étions au chômage, sans grands moyens. L’idée de cette récolte est apparue comme une évidence car elle ne demandait qu’un investissement physique.» Quand ils ont appris que la baie de Roscoff recelait la plus grande concentration d’algues du monde, grâce aux eaux pures du Gulf Stream, ils ont aussitôt investi ce lieu idéal pour leur projet. «Plus de 800 espèces sont répertoriées, 12 sont comestibles et 4 commercialisées, explique Monique, trempée de la tête aux pieds. Ces végétaux anciens sont riches en oligoéléments, en fibres, en protéines et en vitamines. Nous avons commencé à les ramasser à la brouette pour les vendre aux supermarchés du coin comme ornements de leurs étals à poissons. Dix-sept ans plus tard, nous employons seize personnes dans notre usine Algoplus, où nous transformons les algues en aliments et en cosmétiques. Les gens adorent.»
A Montmachoux, en Seine-et-Marne, Sylvette Robert, la quarantaine fringante, règne sur une centaine d’autruches. Le long de la route qui mène au village, sur de grands terrains plats, paradent ces curieux oiseaux préhistoriques aux longs cils. Ils ne volent pas mais courent à plus de 70 km/h et ont survécu aux prédateurs depuis 120 millions d’années, en raison de leur ongle unique capable d’éventrer un lion. L’œil vert aux aguets, Sylvette, qui ne craint pas de les caresser, évoque avec jubilation leur capacité d’adaptation. Elle est la première en France à en avoir fait l’élevage. «C’était en 1986, quand j’ai repris l’exploitation familiale. Il y avait eu la grippe aviaire, la vache folle, et je me suis dit qu’avec les autruches, leur viande goûteuse, leur œuf équivalant à douze œufs de poule, je pourrais en faire commerce.» Un commerce florissant puisqu’elle vend aujourd’hui ses aliments à 200 kilomètres à la ronde.
Un coup de foudre pour le porc de Bayeux ;
A Caen, la famille Poissonnier, elle, a eu le coup de foudre pour le porc de Bayeux. Lorsqu’ils ont su que la race, décimée par la guerre, était en voie d’extinction, les Poissonnier ont vendu leurs autres élevages afin de participer au sauvetage de l’espèce. Auges impeccables, paille propre, odeur de détergent parfumé à la rose, ici, leurs quatorze énormes cochons sont traités comme des princes. Juste à côté de la porcherie, la spacieuse maison familiale accueille des jeunes en difficulté... et la truie la plus médaillée du coin, qui «entre et sort quand elle veut». Armande, 300 kilos de chair rose et noir, se dandine jusqu’au salon où elle s’étend comme un chien en grognant d’aise. «Elle est si attachante !» soupire sous sa moustache frémissante Jean-Louis Poissonnier en lui lançant un regard reconnaissant. Il est fier d’être rentré dans son investissement après trois ans, «sans subventions», et «de vivre en autarcie car, dans notre petit laboratoire, nous transformons nous-mêmes le cochon, sans conservateur, à l’ancienne.»
Un attachement au terroir qui est resté vivace chez les paysans du sud du Cantal. Les deux frères Taillé, Joseph et Marcel, font partie des derniers producteurs de la «Tradition salers», l’un des fromages au lait cru les plus fins de France. En 1961, l’attribution ’une AOC a sauvé cette production fermière. Ses particularités : la tomme de 45 à 50 kilos est fabriquée avec 400 litres de lait d’un seul troupeau, et sa couleur jaune provient du pissenlit et de la renoncule dont les vaches sont friandes. De leur buron des estives, une petite maison de pierre grise de trois pièces – cuisine, salle de transformation du fromage et cave –, les frères veillent sur leur troupeau. Deux fois par jour, le fastidieux travail commence dans les prés battus par les vents. Vache particulièrement maternelle, la salers ne se laisse traire que si son veau est venu la téter au préalable. Les frères enlèvent ensuite délicatement le veau du pis et l’attachent à une patte avant de la mère. «Et pendant qu’elle le câline, je la trais, dit Joseph, joignant le geste à la parole. Comme nous en avons 70, c’est un sacré boulot !» Puis le lait est ramené au buron où son frère Marcel le transforme dans l’atelier ultramoderne, lavé à grande eau javellisée, «dans le respect des normes vétérinaires». C’est ainsi que, du 15 avril au 15 novembre, ce coin d’Auvergne produit 1 400 tonnes du très prisé salers, qui partira aux quatre coins de la planète...
A Niedermorschwihr, en Alsace, les Weinzorn et leurs amis vendangent en rythme. Les terrasses abruptes ne facilitent pas la tâche. «L’an dernier, un cousin est mort quand son tracteur s’est retourné...» Mais la motivation reste forte. «On espère chaque année que le raisin sera bon et le vin tout
autant. A chaque récolte, comme en formule 1, c’est un grand prix qu’on peut gagner», lâche de sa voix puissante le patron. Pendant ce temps, dans le Luberon, Raymond Agnel, 78 ans, coupe à la faucille le lavandin odorant, dont il extraira les essences, comme avant lui son père et son grand-père.
Et, dans la Sarthe, Alain Passard, le cuisinier étoilé, poursuit amoureusement ses expériences dans son «potager d’autrefois». Son ambition : «Faire du légume un grand cru en retrouvant, dans des variétés anciennes comme la betterave jaune ou la carotte blanche, leur saveur et leur parfum oubliés...» Des paysans, libres et maîtres chez eux, qui ont à cœur de ne pas perdre leur âme. Car, avant tout, ils désirent conserver ce goût de l’excellence transmis par leurs aînés. Point final.
Frêle silhouette courbée par le temps et les vents, Paul Bedel, 79 ans, avance à petits pas dans son champ enneigé. Face à lui, la lande s’étire en pente douce jusqu’à la mer. Un bout du monde, ce cap de la Hague, aux confins de la presqu’île du Cotentin. Le vieil homme s’approche d’un muret entourant sa parcelle, afin de le consolider. Il se baisse péniblement, prend dans ses mains calleuses une pierre de granit qu’il appose aux autres, d’un geste habile. «Grâce à ces murs, explique-t-il, le foin sera mieux protégé des embruns salés.» Paul connaît les moindres recoins de ce rude paysage qui l’a vu naître. Il n’en est parti que pour son service militaire et pour se rendre à Lourdes. Quand l’usine de traitement des déchets toxiques de la Hague s’est construite, en 1961, les jeunes du coin ont voulu y travailler. «Moi, j’avais besoin d’avoir les mains noires de terre et l’immensité de la Manche devant les yeux. Ici, la lande, la mer et l’homme ne font qu’un. Je sais que, lorsque pousse le varech au printemps, quinze jours après l’herbe verdira. Dommage que les jeunes n’observent plus leur environnement. Leurs tracteurs sophistiqués les ont coupés de la nature qu’ils croient dominer.
Le bon sens terrien :
C’est faux ! Avec mes deux sœurs, célibataires comme moi, nous avons perpétué la tradition avec nos vieilles machines, notre petit élevage de vaches, nos quatre cochons et la basse-cour. Nous avons toujours pu vivre en autarcie, et même faire des économies», confie-t-il, malicieux. Cette existence simple, ce bon sens terrien des paysans français, Roger Lacharpagne, 54 ans, a su aussi les préserver dans le sud du Berry. Avec son père, Gaston, 85 ans, il possède des lopins de terre entourés de buissons piquants qu’ils remontent encore à la sarclette «pour retenir la terre et éviter que nos 25 moutons et 25 vaches ne changent de pré». Lui aussi est un fervent partisan d’une modernisation lente, où «épargner, c’est mieux qu’emprunter». «J’ai le dosage de nourriture au bout de la fourche. Pour un mouton, un seau d’avoine suffit. Un savoir-faire inné.» Fils unique, il n’a jamais pris un jour de vacances, comme ses parents. «On ne peut pas quitter les bêtes, alors je vois la mer à la télé !» Roger ne vit que pour ses animaux. Se couche à 21 heures mais peut se relever à minuit pour aider une vache à vêler. «La bonne surprise, c’est de voir en arrivant que le nouveau-né tète déjà sa mère. Aucune mécanique ne pourra jamais remplacer la magie de la nature.» Son seul désir aujourd’hui : «Libérer les bêtes de la chaîne.» Dans la cour de la ferme, non loin du tas de fumier, s’ouvre l’étable.
Une dizaine de vaches rousses sont allongées, le cou entravé. Odeur de bouse et d’urine. Gaston empoigne la fourche en bois et nettoie la paille souillée. Impression d’avoir basculé au siècle dernier... Au bout de six générations, le clan Geoffroy, lui, a su allier la tradition à la modernité, par une transmission du savoir de père en fils. Un héritage dont Roger et Paul ont la nostalgie. Ils redoutent d’ailleurs de devoir vendre la ferme de leurs aïeux. Mais, à leur époque, rares étaient les jeunes femmes prêtes à travailler nuit et jour... Rien de tel pour les Geoffroy, qui sont devenus céréaliers en Poitou-Charentes. «J’ai toujours été en avance sur mon temps, raconte Charles, le grand-père. En un seul jour, j’ai acheté trois tracteurs... C’est bien beau, le folklore, mais qu’est-ce que j’en ai bavé pour entasser le foin ! On avait tous mal au dos. Et quand il fallait couper le blé à la faucille ! L’horreur ! Ils sont plus heureux, les paysans d’aujourd’hui. Cultiver des céréales dans des tracteurs climatisés dirigés par satellite, quel plaisir !» Alors qu’il s’occupait d’une vingtaine de vaches laitières, il n’a pas hésité à sauter le pas avec l’aide de son fils et de la Pac (politique agricole commune). Maintenant, face à ses champs mordorés qui s’étendent à perte de vue, il s’amuse, à 80 ans, à jouer au «gentleman farmer», tout en surveillant du coin de l’œil le travail de ses deux petits-fils, juchés sur leurs monstres mécaniques, des moissonneuses-batteuses dont les roues mesurent 2 mètres de diamètre... Les cheveux en bataille, la mine burinée, Sylvain Meyrat, lui, se présente, non sans fierté, comme «un berger sans terre, un nomade qui n’a pas eu la chance d’hériter de pâturages ou de bestiaux». Mais, dans ce coin perdu des Hautes-Pyrénées, le temps des estives, de juin à septembre, ce Basque de 39 ans, dont le regard brille d’un éclat sauvage, se dit «heureux» quand il veille sur un troupeau de 180 brebis manech. Après les avoir emmenées brouter dans les prairies d’altitude, il les guide avec virtuosité sur des sentiers escarpés, vers leur enclos, en contrebas. Deux fois par jour, il les trait à la main pour obtenir 50 litres de lait. «Je fabrique du fromage, je vends des agneaux et je squatte la caravane d’un vieux du coin. Voilà ma vie l’été. Pour l’hiver, on verra bien.»
Le refuge des assoifés d'espaces vierges :
Les vallées encaissées des Pyrénées attirent ces assoiffés d’espaces vierges. Des jeunes gens qui ont fui l’isolement des grandes villes, attirés par une vie saine, rythmée par les saisons. A la ferme équestre de Bernicaze, Adeline Abdallah, 28 ans, a repris un élevage de 50 chevaux de promenade légués par son père. Plantureuse et volontaire, la jeune femme partage un potager avec ses amis afin de consommer des fruits et légumes bio qu’ils cuisinent ensemble selon d’anciennes recettes. Ce jeudi ensoleillé de juin, Eric, un jeune botaniste, leur a concocté une soupe à base de laurier qu’il a ramassé le long des chemins.
Autour de la grande table de la ferme, où chacun passe sans prévenir, on retrouve l’esprit communautaire des hippies des années 70 avec des «rebelles» sans les cheveux longs et mieux intégrés socialement, tel Marc, 30 ans, prof de français, qui enseigne à Lourdes après avoir quitté la banlieue parisienne, «bien trop étouffante»... A Sigottier, village perché dans les Hautes-Alpes, les Lanteaume, Bernard, Catherine et Lilas, 7 ans, n’échangeraient pour rien au monde les chèvres angoras et cachemires dont le couple transforme la laine artisanalement. «En 1983, j’en ai ramené une quarantaine du Texas, par camion, à travers les Etats-Unis jusqu’au Canada, pour éviter les problèmes de douane. Puis elles ont pris l’avion, à nouveau un camion et, au bout d’une semaine, elles sont enfin arrivées à la maison, saines et sauves ! Depuis, elles se sont multipliées, gambadent sur les à-pics des montagnes alentour et, entre mai et novembre, restent sur les sommets, gardées par les patous, des chiens de berger efficaces.» Avec leur vente directe de lainages de qualité et leur gîte rural qui domine la vallée, ils ont réussi leur pari.
Dans un coin du nord de la Bretagne, enivrés d’iode, Monique Poulet et Michel Pertzinsky profitent de la marée basse pour ramasser avec ardeur des brassées d’algues, ravis de trouver «tant de laitue de mer, aujourd’hui». «En 1993, Michel et moi vivions en Normandie. Nous étions au chômage, sans grands moyens. L’idée de cette récolte est apparue comme une évidence car elle ne demandait qu’un investissement physique.» Quand ils ont appris que la baie de Roscoff recelait la plus grande concentration d’algues du monde, grâce aux eaux pures du Gulf Stream, ils ont aussitôt investi ce lieu idéal pour leur projet. «Plus de 800 espèces sont répertoriées, 12 sont comestibles et 4 commercialisées, explique Monique, trempée de la tête aux pieds. Ces végétaux anciens sont riches en oligoéléments, en fibres, en protéines et en vitamines. Nous avons commencé à les ramasser à la brouette pour les vendre aux supermarchés du coin comme ornements de leurs étals à poissons. Dix-sept ans plus tard, nous employons seize personnes dans notre usine Algoplus, où nous transformons les algues en aliments et en cosmétiques. Les gens adorent.»
A Montmachoux, en Seine-et-Marne, Sylvette Robert, la quarantaine fringante, règne sur une centaine d’autruches. Le long de la route qui mène au village, sur de grands terrains plats, paradent ces curieux oiseaux préhistoriques aux longs cils. Ils ne volent pas mais courent à plus de 70 km/h et ont survécu aux prédateurs depuis 120 millions d’années, en raison de leur ongle unique capable d’éventrer un lion. L’œil vert aux aguets, Sylvette, qui ne craint pas de les caresser, évoque avec jubilation leur capacité d’adaptation. Elle est la première en France à en avoir fait l’élevage. «C’était en 1986, quand j’ai repris l’exploitation familiale. Il y avait eu la grippe aviaire, la vache folle, et je me suis dit qu’avec les autruches, leur viande goûteuse, leur œuf équivalant à douze œufs de poule, je pourrais en faire commerce.» Un commerce florissant puisqu’elle vend aujourd’hui ses aliments à 200 kilomètres à la ronde.
Un coup de foudre pour le porc de Bayeux ;
A Caen, la famille Poissonnier, elle, a eu le coup de foudre pour le porc de Bayeux. Lorsqu’ils ont su que la race, décimée par la guerre, était en voie d’extinction, les Poissonnier ont vendu leurs autres élevages afin de participer au sauvetage de l’espèce. Auges impeccables, paille propre, odeur de détergent parfumé à la rose, ici, leurs quatorze énormes cochons sont traités comme des princes. Juste à côté de la porcherie, la spacieuse maison familiale accueille des jeunes en difficulté... et la truie la plus médaillée du coin, qui «entre et sort quand elle veut». Armande, 300 kilos de chair rose et noir, se dandine jusqu’au salon où elle s’étend comme un chien en grognant d’aise. «Elle est si attachante !» soupire sous sa moustache frémissante Jean-Louis Poissonnier en lui lançant un regard reconnaissant. Il est fier d’être rentré dans son investissement après trois ans, «sans subventions», et «de vivre en autarcie car, dans notre petit laboratoire, nous transformons nous-mêmes le cochon, sans conservateur, à l’ancienne.»
Un attachement au terroir qui est resté vivace chez les paysans du sud du Cantal. Les deux frères Taillé, Joseph et Marcel, font partie des derniers producteurs de la «Tradition salers», l’un des fromages au lait cru les plus fins de France. En 1961, l’attribution ’une AOC a sauvé cette production fermière. Ses particularités : la tomme de 45 à 50 kilos est fabriquée avec 400 litres de lait d’un seul troupeau, et sa couleur jaune provient du pissenlit et de la renoncule dont les vaches sont friandes. De leur buron des estives, une petite maison de pierre grise de trois pièces – cuisine, salle de transformation du fromage et cave –, les frères veillent sur leur troupeau. Deux fois par jour, le fastidieux travail commence dans les prés battus par les vents. Vache particulièrement maternelle, la salers ne se laisse traire que si son veau est venu la téter au préalable. Les frères enlèvent ensuite délicatement le veau du pis et l’attachent à une patte avant de la mère. «Et pendant qu’elle le câline, je la trais, dit Joseph, joignant le geste à la parole. Comme nous en avons 70, c’est un sacré boulot !» Puis le lait est ramené au buron où son frère Marcel le transforme dans l’atelier ultramoderne, lavé à grande eau javellisée, «dans le respect des normes vétérinaires». C’est ainsi que, du 15 avril au 15 novembre, ce coin d’Auvergne produit 1 400 tonnes du très prisé salers, qui partira aux quatre coins de la planète...
A Niedermorschwihr, en Alsace, les Weinzorn et leurs amis vendangent en rythme. Les terrasses abruptes ne facilitent pas la tâche. «L’an dernier, un cousin est mort quand son tracteur s’est retourné...» Mais la motivation reste forte. «On espère chaque année que le raisin sera bon et le vin tout
autant. A chaque récolte, comme en formule 1, c’est un grand prix qu’on peut gagner», lâche de sa voix puissante le patron. Pendant ce temps, dans le Luberon, Raymond Agnel, 78 ans, coupe à la faucille le lavandin odorant, dont il extraira les essences, comme avant lui son père et son grand-père.
Et, dans la Sarthe, Alain Passard, le cuisinier étoilé, poursuit amoureusement ses expériences dans son «potager d’autrefois». Son ambition : «Faire du légume un grand cru en retrouvant, dans des variétés anciennes comme la betterave jaune ou la carotte blanche, leur saveur et leur parfum oubliés...» Des paysans, libres et maîtres chez eux, qui ont à cœur de ne pas perdre leur âme. Car, avant tout, ils désirent conserver ce goût de l’excellence transmis par leurs aînés. Point final.
 Re: Paul Bedel et les autres dans Paris Match.
Re: Paul Bedel et les autres dans Paris Match.
Passard a aussi un jardin dans la Manche face au Mont tenu par son frère.
 Sujets similaires
Sujets similaires» Quéffélec en anti-Normand dans Paris Match.
» Paul Bedel
» Lettre à la rédaction de Paris Match
» Colloque "L'Eure dans le Grand Paris" à Evreux le 17 Janvier
» Autres brasseries Normandes
» Paul Bedel
» Lettre à la rédaction de Paris Match
» Colloque "L'Eure dans le Grand Paris" à Evreux le 17 Janvier
» Autres brasseries Normandes
Normanring :: Divers
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum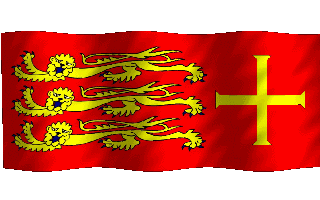
 Notre site
Notre site